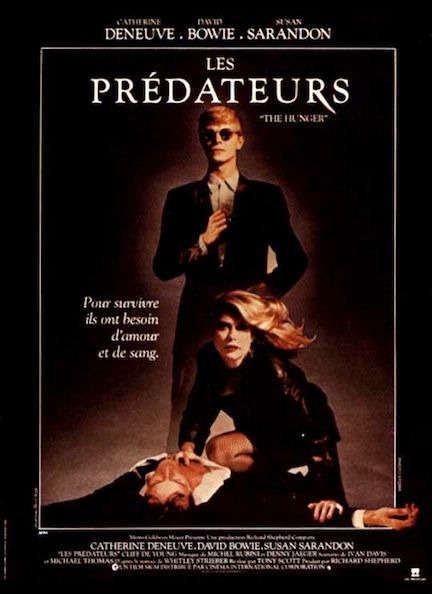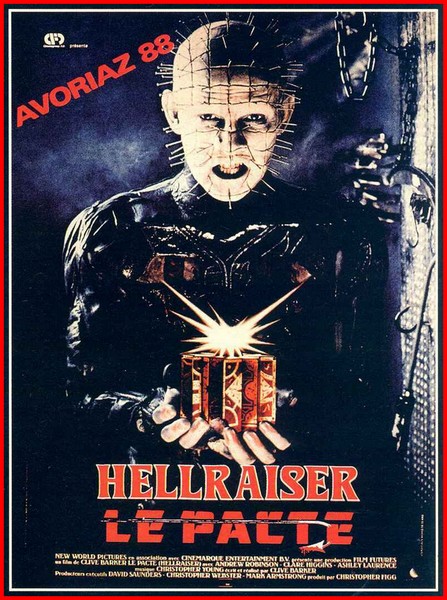Salut les loupiots,
Il y a déjà un petit moment de ça (quand je vivais à Montréal, pour être exact : ceux qui suivent attentivement le fil de ma vie replaceront facilement cette période[1]) je me suis senti le goût de regarder tout un tas de films se passant sous l'océan. J'ai évité "La Petite Sirène", j'ai savouré Abyss et pour le reste je me suis enfilé une flopée de bobines à la qualité variable. L'un de ces films s'appelait...
DEEP RISING!!! (Et y a pas d'raison pour gueuler comme ça.) J'ai donc découvert que ce film n'est autre que "Un Cri dans l'Océan", que j'avais vu et apprécié à sa sortie en salle ; et j'ai découvert par la même occasion que l'ado que j'étais avait vraiment des goûts de chiotte.
Une affiche qui en jette! Même à l'époque on trouvait de meilleurs graphistes, mais notez qu'on aperçoit déjà Famke Janssen derrière, qui est le seul intérêt du film.
Avant tout, quelques mots sur les coupab... sur l'équipe du film. J'ignore si la personne qui faisait le café en faisait du bon, mais j'espère que oui : au moins, quelque chose de bon est sorti de ce film. Pour le reste, le réalisateur est Stephen Sommers à qui l'on doit un paquet de bouses qu'on est rarement assez jeunes ou assez bourrés que pour pouvoir apprécier ne serait-ce qu'un peu. Les acteurs quand à eux m'intriguent : certains ont prouvé être capables de jouer correctement dans d'autres films (Wes Studi par exemple, à qui je pardonnerai peut-être un jour Avatar mais jamais Deep Rising ; Famke Janssen à qui je serai éternellement reconnaissant pour la façon dont Xenia Onatopp m'a troublé à l'époque ; Djimon Hounsou...) mais semblent aussi motivés à jouer dans ce film que moi à aller chez le coiffeur.
 Cette scène est drôle parce que ce film, qui pompe un paquet de bons trucs et de bouses d'Hollywood, semble ici copier... une des BD Tintin!
"Famke Janssen et le Crabe aux Pinces d'Or", mais ouais!
Cette scène est drôle parce que ce film, qui pompe un paquet de bons trucs et de bouses d'Hollywood, semble ici copier... une des BD Tintin!
"Famke Janssen et le Crabe aux Pinces d'Or", mais ouais!
Le film s'ouvre sur trois lignes de textes qui nous parlent des canyons sous-marins en mer de Chine capables de planquer l'Himalaya (si vous avez un Himalaya à ranger, pensez à la mer de Chine) et des nombreux bateaux qui ont disparu dans cette zone. Ensuite, on voit des épaves partout au fond de l'eau et une caméra tremblotante et des sons moches nous font comprendre qu'on voit tout comme si on était... la BÊTE! L'ambiance effrayante étant plantée (quoi?!?), on enchaine avec une musique héroïque, un bateau rapide qui fend les vagues et le premier plan sur nos héros. Parlons en, de ces chevaliers des temps modernes! Le personnage principal est un vieux beau qui surjoue son rôle de badass à qui on la fait pas. Son acolyte est très... acolyte : voix de gamin qui a pas encore mué (j'avais un coloc comme ça à Montréal : y a des têtes à claque, ben les gens avec ce genre de voix ont des "voix-à-claque" ! ), look d'informaticien mal coiffé et éternel gueule de victime. Il y a aussi une fille avec eux, une jolie asiatique qui se fera buter assez vite puisqu'elle a pas respecté la règle de survie de ce genre de films quand tu es une femme : tape-toi le héros, ou crève. (Au passage, dans la réalité vous êtes pas obligées de toujours vous taper le beau héros, les filles : faire zizi-panpan avec un couillon dans mon genre ne présente aucun risque pour votre santé. Je le dis en passant...)
Il faut savoir que le personnage principal avait été écrit pour Harrison Ford. Bon, je dis pas qu'il a fait que des merveilles, le coco[2], mais il faut pas pousser ! Même Colin Farell aurait hésité à accepté de jouer dans un tel film ! Ensuite, après les bons ("bons" dans le sens "gentils", hein : sinon, ils jouent excessivement mal), on voit les méchants : un groupe de gros bras aux mines patibulaires [3] qui disent des gros mots, parlent de femmes en termes pas très respectueux et se menacent avec des pistolets et des haches à la moindre engueulade. Hé bé, avec un tel tableau j'ai même pas eu besoin d'une musique dramatique pour comprendre qu'ils allaient poser des soucis à nos trois héros, ceux-là !
Y en a même un qui a pas un mais bien DEUX anneaux dans l'oreille gauche (double anarcho-pirate ! ).
Mais comme on l'a compris dès qu'on a eu droit aux plans de caméra pourraves entre les épaves, les méchants seront le moindre des soucis de nos héros. ("Nos" héros, "nos" héros... façon de parler hein : ils ne sont pas plus à moi qu'à vous.)
(Bon, entre tous les défauts de ce film je dois signaler un petit couac qu'on ne peut reprocher à personne : à chaque fois que le chef des vilains pointe son museau, j'avais la musique épique de "Last of the Mohicans" qui me venait en tête, parce que c'est le même gars qui jouait le vilain chef des Indiens.)
 Une scène inutile dans un film inutile...
Une scène inutile dans un film inutile...
Ensuite, je vous passe les détails du "comment que ça arrive", mais en gros le réalisateur nous fait comprendre que le propriétaire d'un gros bateau de croisière a fait exprès de mettre son bateau en panne pour que les méchants le pillent, et qu'il l'a fait juste au-dessus de la tanière du monstre (l'imbécile[4]). En gros, le bateau fait "pchhhht" et ne fonctionne plus, le monstre arrive et fait "boum" sur la coque et commence à bouffer tout le monde, à commencer par une jolie asiatique dans les toilettes. (Je sais pas il a quoi contre les jolies asiatiques, le réalisateur. Un souci avec une ex venue du levant peut-être ?...) Du coup, quand nos héros et les sales types le prennent d'abordage, tout le monde a disparu, à part une jolie fille (un héros hollywoodien sans sa demoiselle en détresse à sauver c'est comme un burger MacDonald sans ketchup : c'est pas bon de toute façon, mais ça se fait pas, on sait pas pourquoi mais c'est comme ça), le capitaine, le propriétaire du bateau et quelques autres futures victimes qui serviront surtout à gicler sur les murs de temps à autre afin d'occuper le spectateur. La suite est assez rythmée : un plan de caméra mal foutu, un humain qui repeint les murs de son sang, une blague vaseuse du héros; un plan de caméra foireux, un malheureux qui s'éparpille du sol au plafond, une feinte digne de moi prononcée par le héros... (Pour ceux qui voudraient regarder ce film, j'espère que ça vous plait parce que c'est quand même que ça pendant une bonne heure...) Au bout d'un paquet de cadavres, notre héros, son pote qui se prend les baffes et la jolie poulette qu'il ramène sous le bras se retrouvent dans son bateau et décident de tout faire péter avant de fuir sur l'île qui se trouve à deux pas (ha oui, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait il y a une île juste à côté de là où tout le bousin se déroule : que le monde est petit quand même!). L'acolyte est bien un peu triste de constater que sa copine est morte, mais sans plus. C'est d'ailleurs le moment le moins crédible du film: quand un gars avec une gueule de con, un humour déplorable et un charisme de caneton parvient par miracle a séduire une jolie asiatique, il met pas 5 minutes à se remettre de son départ, et je sais de quoi je parle[5]. (C'est d'ailleurs sans doute pire si la demoiselle disparait bouffée par un monstre, marin ou autre, mais là je sais pas de quoi je parle.)
 Je... je dois vraiment commenter la bêtise machiste de cette scène? Non parce qu'il parait que c'est de l'humour...
Je... je dois vraiment commenter la bêtise machiste de cette scène? Non parce qu'il parait que c'est de l'humour...
Comme on a pas payé pour rien, on a droit à une confrontation directe avec la bestiole. En effet, par manque de chance notre héros se fait attraper par le vilain monstre, mais par chance (cette fois) ce dernier décide de ne pas le bouffer tout de suite (comme il a fait avec ses centaines de premières victimes, hein) mais de jouer avec tel un hochet, ce qui permet au courageux marin de lui tirer dans l’œil avec son gros fusil.
Ça faut lui laisser : les armes sont de belle taille dans ce film: il faut dire que pour attaquer un bateau rempli de rupins armés de talons aiguilles et de jetons de poker, les pirates ont amené assez d'armes et de munitions que pour envahir la Corée du Sud. Détail amusant, dès que la demoiselle tente d'utiliser un flingue, elle rate, ou elle fait une connerie (d'ailleurs c'est sensé être drôle: "hu hu, femme pas douée pour utiliser symboles phalliques").
 Comme quoi j'ai pas uniquement foutu des photos de ce film avec Famke Janssen: je suis pas ce genre de gars.
Comme quoi j'ai pas uniquement foutu des photos de ce film avec Famke Janssen: je suis pas ce genre de gars.
Bref, ça se termine sur une plage avec le comique (qui a survécu : ça leur arrive parfois), la future poupée sexuelle et l'inévitable héros, tout contents d'avoir vaincu. Et comme le réalisateur y croyait très fort, le dernier plan nous montre des arbres qui tombent rapidement au loin, comme si un énorme bidule était en train d'avancer très vite dans la forêt... (Oui, il a osé, je vous niaise pas ! )
\o/ Bonus \o/
Petit jeu rigolo :
Dès que vous repérez un "emprunt" fait à un classique du cinéma, vous le faites remarquer à vos compagnons de beuverie et vous descendez un verre de gin. Le but est d'être assez sobre à la fin du film que pour continuer de le trouver mauvais. "Alien", "The Thing", "Tremors", "Leviathan", "Jaws"…
LA blague du héros :
Poulette mignonne : "You have a boat out there ?"
Héros cynique : "Yes..."
Poulette bonnarde : "I you get me out of here..."
Héros sur de lui : "...I can have whatever I want ?"
Poulette surbaisable : Yes, whatever you want !"
Héros overcool : "Can you get me a cold beer ?"
Poulette baisissimable : "Very funny..." (Sur ce point, je suis d'accord avec elle.)
[1] Heu... get a life, guys ! Non mais vraiment, en plus ça fait flipper d'imaginer que quelqu'un puisse réellement me suivre à la trace de la sorte.
[2] Je le répète : Indiana Jones est une trilogie, et un épisode 4 n'a jamais vu le jour. JAMAIS ! Tout comme Terminator 3 ou un hypothétique rachat de Star Wars par Disney : c'est juste des racontars que les grandes personnes disent aux enfants pas sages comme moi pour leur faire peur !
[3] Comme on dit chez nous, "avoir de telles mines, c'est pas de veine". (Oui bon, je sais qu'elle est nulle ma blague, mais au moins elle est OK pour les mineurs...)
[4] Le propriétaire du bateau, pas le réalisateur. Enfin... les deux, disons.
[5] Je... ouais, je sais de quoi je parle parce que c'est arrivé à un pote. Voilà tout.