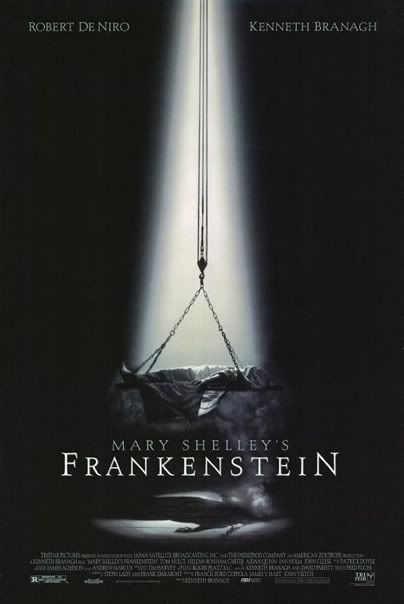Le projet était osé, pas le fait de retranscrire l’histoire sur grand écran, mais plutôt de le confier à une parfaite inconnue (Lynne Ramsay) qui s’était surtout illustrée dans le monde des court-métrages. Et la première chose que j’ai envie de dire, c’est qu’elle s’en est plutôt sortie avec brio.
Les premières minutes peuvent être assez déconcertantes pour le public qui n’a pas lu le bouquin, dû aux nombreux aller-retours passé-présent-passé plus lointain mais cela nous permet de bien rentrer dans le personnage de la mère de Kevin (magistralement interprétée par Tilda Swinton) qui essaie de vivre le jour présent mais finalement n’arrive pas à ressortir de son douloureux passé. Et pour cause, voici son histoire :
Eva a décidé de mettre sa carrière de côté quand elle a appris sa grossesse et ainsi s’occuper de l’éducation de son fils, Kévin. Et tout ne vas pas être de tout repos, Kévin ayant un comportement des plus bizarres, présente des signes de retard intellectuel (ne parle pas avant 5ans ou ne s’exprime qu’avec des borborygmes, porte des couches jusqu’à 9ans) mais n’est en aucun cas victime d’une pathologie. Eva va donc vivre aux rythmes des désagréments du quotidien apportés par son petit monstre de fils. Tout va aller de mal en pis, jusqu’à ce que Kevin ne commette l’irréparable, un massacre dans son lycée.
Je ne rentrerai pas dans la polémique un livre/un film que j’affectionne pourtant énormément à l’habitude, mais We need to talk about Kevin m’avait tellement bouleversé à la fin de sa lecture (m’arrachant même quelques seaux de larmes dans les 30 dernières pages), un des rares livres qui m’aient mis dans un tel état que je ne serais pas objectif. Le montage est plutôt bien traité, et ce n’était pas évident de basculer d’un roman qui à la base est épistolaire ; on laisse donc tomber le côté correspondance entre Eva et son mari pour suivre directement le quotidien post-massacre d’Eva entre recherche de travail, vandalisme sur sa propriété, visites à son fils en prison tout cela rythmé aussi par des flashback, de la rencontre de son mari, naissance de Kevin puis son enfance, l’arrivée de la petite sœur, et enfin l’adolescence du futur meurtrier.

Dur, dur d'être les parents d'un petit psychopathe
Outre Tilda Swinton, John C. Reilly (Magnolia, Boogie Nights, The Hours…) et Ezra Miller complètent le casting. Leur interprétation n’a rien d’exceptionnel en soi mais tout à fait juste, Reilly en papa poule qui donne toujours raison à son fils, Ezra incarne lui un Kévin détestable à souhait.
D'ailleurs le casting spécifique à Kevin selon son âge est vraiment super raccord (cf photo ci-dessous), le petit gamin tout à droite dont je ne connais pas le nom et qui joue le petit monstre à l’âge de neuf ans est celui qui m'a le plus bluffé au niveau de l'interprétation.

L'approche psychologique de Kevin est très bien abordé, dès sa plus tendre enfance il se complait dans la destruction et deviendra son terrain de jeu favori (pourrir le mur du bureau de sa mère, collectionner les virus informatiques, tir à l'arc sur ses camarades..) bien que quelques horreurs du livre soient mises de côté ou abordées de façon moins horrible. L'évolution des rapports entre mère et fils une fois que Kevin est incarcéré est elle aussi bien traité, reste peut-être moins nuancé mais tout de même conforme au livre.
Il me semble que pour ma preview je vous disais que l’impatience de voir ce film était à double tranchant, satisfaction ou déception, je pencherai plutôt du côté de la satisfaction même si on pourra noter la trop grande dominance de la couleur rouge pour la photo qui est un peu maladroite à mon avis, et bien évidemment connaissant la fin, pas la même montée en pression qu’un spectateur ‘vierge’ (mais apparemment cela bien fait son effet sur la personne qui a regardé le film avec moi et qui n’avait pas lu le bouquin). Une adaptation de livre plutôt réussie donc, ça se fait rare par les temps qui courent !
BANDE-ANNONCE