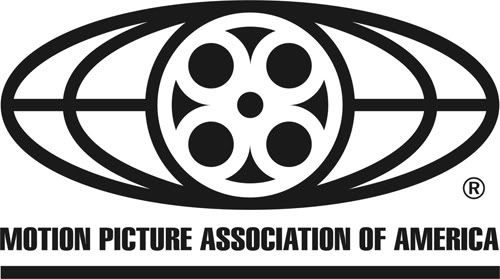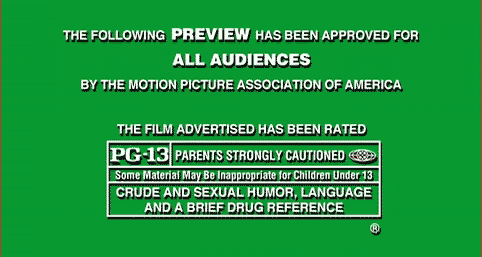Ce long-métrage de presque 3 heures met en scène Tom Hanks, Tom Sizemore, ainsi que Matt Damon ou encore Vin Diesel.

Synopsis
6 juin 1944. Après des mois d'attente, l'opération Overlord commence et le débarquement en Normandie a lieu. John Miller, capitaine d'une compagnie de Rangers est dans la première vague à débarquer à Omaha Beach.
Après une lutte sanglante et acharnée pour le contrôle de la plage, les Américains prennent pied en France et parviennent à repousser les Allemands hors des côtes.
Cependant après cette difficile victoire, une mission encore plus délicate est confiée à Miller.
Il doit en effet partir à la recherche d'un soldat parachuté derrière les lignes ennemies : James Ryan, afin de le ramener au pays.
En effet, Ryan a perdu ses trois frères à la guerre et le chef d'état-major des armées lui-même, Georges Marshall, désire ramener ce quatrième frère en vie à sa mère.
Commence alors pour Miller et ses hommes une longue quête en territoire ennemi. Mais alors que l'ennemi se fait de plus en plus présent, des questions divisent la troupe du capitaine.
La vie d'un seul homme mérite-elle qu'on lui sacrifie plusieurs autres ? D'autant plus que personne ne sait si Ryan est toujours en vie.

Analyse
Il faut sauver le soldat Ryan marque le spectateur d'entrée de jeu par une reconstitution hyper-réaliste du débarquement allié à Omaha beach. La reconstitution est quasi-historique et le réalisme est poussé à l'extrême, sombrant parfois dans l'horreur et le gore. Néanmoins, comment reprocher à un film de guerre, relatant un évènement historique, de se montrer vrai, bien que jugé cru à sa sortie.
Le résultat est là malgré tout et le spectateur est rapidement immergé dans cette bataille qui semble désespérée. On ressent clairement le coupe-gorge dans lequel se débat l'armée américaine et la caméra parfois subjective renforce encore plus cet aspect. Le mixage et la bande sonore (récompensés aux Oscars) sont d'une grande qualité et la déflagration des obus et des cartouches finissent de nous faire revivre cette bataille acharnée.
Spielberg réussit un coup de maître en tournant l'une des scènes étant considérée comme la meilleure scène de bataille du cinéma par de nombreux magazines. Plus d'un millier de figurants, le double en armes et un total de 11 millions de dollars auront été nécessaires pour tourner ce début de film qui dure pas loin de trente minutes, ce qui pour une introduction s'avère particulièrement long.
Le réalisateur n'a pas précipité sa mise en scène et laisse donc tout le temps nécessaire à son film pour se mettre en place, lui conférant ainsi un grand réalisme et un contexte marquant.

La photographie du film jouit d'une grande qualité, notamment lors de la scène du débarquement. L'image semble assez épurée, très peu de couleurs vives composent la scène. Seul le sang se démarque et cela renforce l'aspect visuel de la mise en scène. La luminosité est assez faible, le débarquement ayant eu lieu très tôt le matin. L'esthétique est très convaincante et Janusz Kaminski sera oscarisé pour son travail à la photographie. À noter également l'utilisation de caméras sous-marines qui enrichissent le visuel du film et le côté réaliste, montrant ainsi que de nombreux soldats sont morts noyés, ceux-ci ne pouvant débarquer sur la plage, ont alors essayé de nager jusqu'à elle, devant supporter la charge trop lourde de leurs équipements ou les mitrailleuses allemandes.
Au niveau des acteurs, on peut noter une grande qualité dans l'interprétation de Tom Hanks qui incarne un capitaine tout ce qu'il y a de plus humain au niveau des émotions. On ne tombe pas dans le cliché de l'officier américain à la grosse voix et au cigare. Il en va de même pour l'ensemble des acteurs constituant la troupe de Miller.
Chacun possède son propre caractère, plutôt bien mis en avant, et ceux-ci rendent bien compte des tensions qui peuvent se développer dans un groupe durant l'exécution d'une mission controversée. Néanmoins ils parviennent à rester solidaires dans l'adversité sans surjouer et stéréotyper le militaire américain en héros.
Tom Hanks est donc bien entouré, principalement par Tom Sizemore qui une fois de plus endosse l'uniforme pour le rôle de dur à cuir qui lui va si bien et par Matt Damon qui, un an après son Will Hunting, passe devant la caméra pour Spielberg, dans le rôle d'un jeune soldat courageux, sans trop en faire cependant. Il rend bien compte de l'esprit de camaraderie qui peut naître entre soldats et son interprétation est bien dosée.

Malgré quelques erreurs techniques (parfois volontaires), Spielberg nous offre une fois de plus un grand moment de cinéma et évoque l'une des plus grandes pages de notre histoire avec réalisme et une certaine neutralité. Il ne cherche pas à enfoncer les soldats allemands et à valoriser l'armée américaine. Il se contente de filmer une histoire, certes plus d'un point de vue que de l'autre, mais sans perdre de vue son objectif principal, qui n'est pas d'encenser les victoires alliées, mais de raconter l'histoire d'un groupe de soldats durant la seconde guerre mondiale et d'en profiter ainsi pour traiter ces évènements qui ont marqué l'histoire.
Un grand film donc, pour trois heures d'immersion dans un des conflits les plus célèbres du vingtième siècle. De plus, venant du réalisateur américain, la bande originale n'est pas en reste, puisque c'est John Williams qui s'y colle pour nous offrir une nouvelle fois une musique sublime qui épouse parfaitement le film. Même si le côté symphonique reste courant dans les films de guerre, l'essentiel est que l'effet soit là et que les morceaux s'accordent harmonieusement avec les différentes scènes et c'est le cas ici et plus encore.
Williams alterne les morceaux très instrumentalisés et symphoniques pour renforcer les moments forts du films et des morceaux plus intimistes pour mettre en avant des moments plus calmes ou qui font monter la tension de l'intrigue. Rien de très novateur en somme, mais la recette marche tellement bien.
Pour conclure, Saving Private Ryan est un excellent film, maintes fois récompensé. Avec un large budget de presque 90 millions de dollars, Spielberg a réussi à rendre son long-métrage grandiose et authentique.
À voir, et je dirais même plus, à voir sur écran géant (comme si c'était facile :p)

Trailler
OST - Omaha beach
OST - Finding pvt. Ryan
OST - Approaching The Enemy
OST - Tu es partout (Edith Piaf)