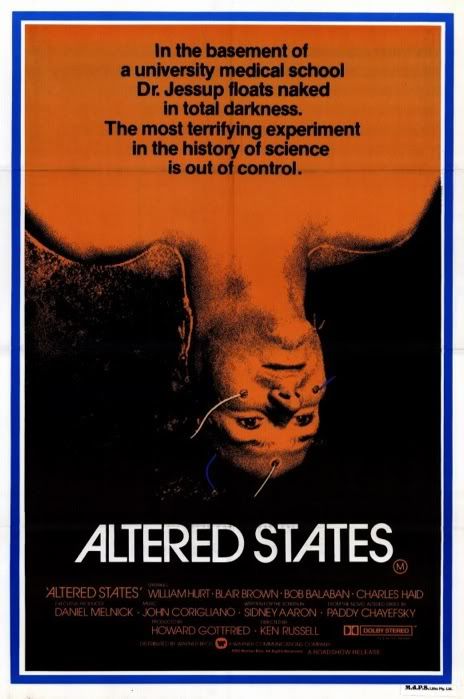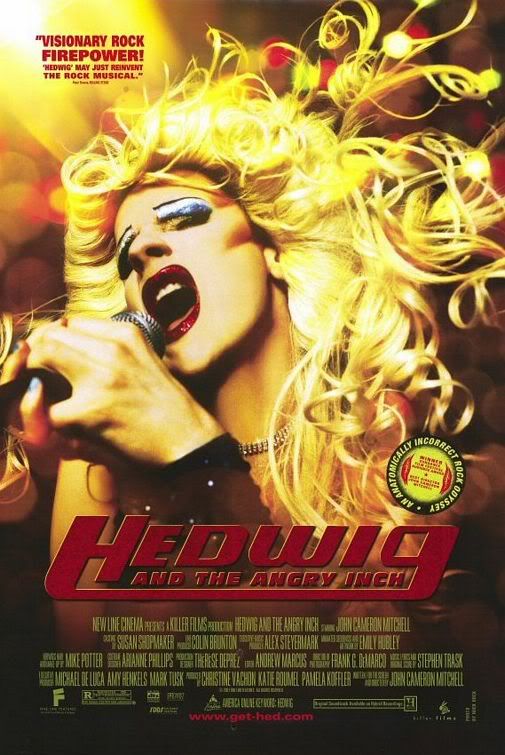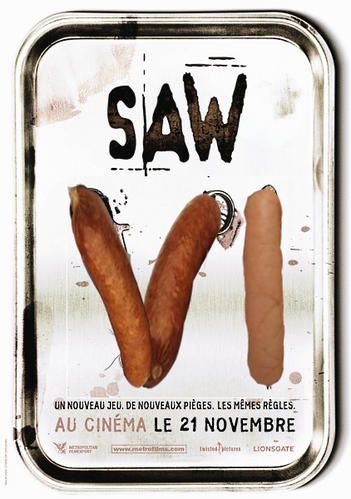Le cinéma, c’est devenu quelque chose de radicalement compliqué. Tandis qu’il y a 60 ans, on trouvait juste une petite bande de potes au générique, désormais c’est une véritable armée qui défile sur fond noir avec de la mauvaise musique (ou pas). Des machinistes, des électriciens, des coiffeurs, des hommes-sandwich, et aussi des mecs qui font du son. On a vraiment besoin d’être 40 pour tenir un micro et appuyer sur des boutons ? Et bien oui, et c’est ce que je vais tenter de vous faire comprendre, sans rentrer dans la technique, qui vous vous en doutez, demande un paquet d’années de formation, de litres de café, de bide qui pousse et de cheveux qui tombent.
Partons d’un exemple concret, avec un personnage fictif, nommé Robert. Robert a 40 piges, il gère à mort l’électronique, l’acoustique, son père est artiste peintre et sa mère vit de sa rente, il a été pistonné mais a aussi beaucoup de talent. Il sera donc notre superviseur technique dans le domaine de la production sonore. Robert vient d’être nommé pour un film de grande envergure, un film avec des robots qui se cognent et des filles avec des jolis culs, « Tranformateur » de Michel Bon, il sera présent partout tout le temps, il ne dormira pas beaucoup, c’est certain.
Robert a donc du pain sur la planche, et doit réunir son armée pour avoir un son qui vrille les tympans et toucher un chèque très convenable, et pourquoi pas avoir une statuette dorée pour le son qui envoie le plus la purée ? Tout doit être parfait, et dans chacune de ces étapes : la pré-production, la production (le tournage quoi), et enfin la post-production.
Allons-y pour la pré-production, Robert doit nous dégoter :
- Un
directeur artistique : c’est lui qui, à l’aide de Robert, et en accord avec Michel bon, va devoir définir l’aspect global du rendu sonore, quel son fera le grand chef des robots quand il pète, quelle musique va-t-on mettre quand Morgane Fauxe lave une voiture avec ses nichons, etc… en gros, il fait pas grand chose, il écrit juste des grandes lignes et boira du whisky avec Michel Bon tous les soirs pour se foutre de la gueule de tel ou tel technicien.
- Un
chargé de production : c’est lui qui va analyser chaque scène et définir les besoins humains et matériels pour chacune d’entre elles, en d’autres termes : le découpage technique. Combien de micros à placer quand le robot défonce une benne à ordure, en stéréo ? en surround ? Combien ça va coûter ? Doit-on demander une rallonge de budget, ou prendre des stagiaires ? Combien de personnes pour manipuler tout ça, de combien de pistes a-t-on besoin ? Y-aura-t-il beaucoup de bruit sur le plateau ? Ce décolleté permettra-t-il de dissimuler un micro entre les saintes mamelles ? C’est une étape longue, fastidieuse et très importante, la préparation doit être au poil. Naturellement, l’argent prend ici beaucoup de place dans les débats. Le chargé de prod’ passe 80% de son temps au téléphone, il se fait engueuler sans arrêt par le producteur, et a un talent inné pour gérer 98 trucs en même temps.
Sur le tournage, finie la branlette ça rigole plus, normalement tout est prêt, et ça se bouscule au portillon, Robert a du trouver sur Facebook :
- Un
chef opérateur : C’est lui qui va effectuer l’enregistrement des différentes sources, il dispose pour cela d’un enregistreur multi-pistes, d’un écran de contrôle, d’une petite table appelée
roulante où il va rassembler tous ses accessoires, parmi lesquels des récepteurs sans fils, des câbles, une petite table de mixage, des instruments de mesure sonore, de Time-Code etc… Généralement le setup complet coûte le prix d’une maison. Bref, sur le plateau son, c’est lui le grand chef, et c’est le seul membre de l’équipe à pouvoir réclamer que l’on refasse une prise à cause du son. Il s’assure d’enregistrer les sons « directs », directement liés à l’action, et également des sons seuls, bien souvent l’ambiance d’une pièce, d’un lieu, le bruitage d’un élément du décor etc… Tout ceci interviendra plus tard au montage. Le chef op’ est souvent assez vieux et très fiable, il fume 3 paquets par jour et a la gueule de bois chaque matin.
 fantasme ultime, et oui
fantasme ultime, et oui
- Un
perchman : Véritable artiste de l’ombre, le perchman s’assure de placer le micro principal au cœur de l’action, à l’aide d’une longue perche en carbone, au bout de laquelle est fixé un micro (souvent appelé micro-canon, c’est à dire très directif) et son dispositif de protection anti-vent, la cage acoustique. Ce brave homme doit prendre soin de ne pas rentrer dans le cadre, de ne pas faire d’ombre, de ne pas faire de bruit, sous peine d’entendre un «
COUPEZ » et d’avoir l’air bien con. Bref, le perchman est une belette, un homme sans ombre, discrétion et coopération avec les gens de l’image sont ses meilleurs alliés. Il est souvent de gauche, s’habille avec des vêtements usés mais confortables, et est contre l’intervention en Lybie.
 Non, ce n'est pas un chien mort au bout de la perche
Non, ce n'est pas un chien mort au bout de la perche
- L’
assistant son : souvent un jeune Padawan plein d’ambition et déterminé à grimper les échelons, son rôle n’en est pas moins primordial, car c’est souvent lui qui va le plus collaborer avec les acteurs pour le placement des micros HFs, ces fameuses capsules micro miniatures que l’on va dissimuler sous les vêtements de la manière la plus discrète et la moins gênante possible, afin de ne pas rater le moindre mot. Tout un art ! D’autant qu’il y a un câble qui va se balader dans les vêtements de la victime, pour rejoindre le transmetteur sans fil, que l’on met où il y a de la place… ça finit souvent au niveau du cul. Bref, avec du casting féminin, ce petit gredin a le joli rôle, puisqu’il doit savamment étudier les formes opulentes des sources à enregistrer.
- Un
deuxième assistant son : il met du scotch sur les câbles, pose sans arrêt des questions à Michel Bon et à Robert, il fait du café et demande sans arrêt aux autres s’il veulent bien transmettre son CV de merde à quelques clients. Son avenir semble radieux.
Naturellement, le directeur artistique et Robert sont présents, car ils gagnent mieux leur vie que les autres, et qu’il faut bien justifier tout ça.
Pour la post-production, là il y a du monde, et le processus prend souvent plusieurs mois, voire un an. Lorsque le montage-image est terminé (ou pas !), tout se fait dans cet ordre-là…
- Le
compositeur : il a commencé à bosser il y a quelques semaines, il reçoit des séquences au fur et à mesure, en accord avec le directeur artistique, quelques partitions, qu’il va pouvoir finaliser une fois le précieux montage-image final reçu. C’est un métier de longue haleine, où il faudra créer une musique qui donnera en quelque sorte le ton du film. Bref, faut du talent, et un paquet d’années de conservatoire. Bien souvent, il s’agit de gens avec des cheveux longs qui sont pétés de thunes. Naturellement, la production de la musique en elle-même fait appel à des dizaines d’autres intervenants du monde du son, mais c’est une autre histoire !
- Le
monteur son direct : Souvent appelé aussi
monteur dialogue, c’est lui qui va se charger de faire le montage des sources sonores enregistrées au tournage. Le chef opérateur lui a transmis un
rapport-son qui décrit chaque piste et son contenu. Le monteur direct choisit ce qui est utile, enlève ce qui ne l’est pas, nettoie les bruits parasites, et dresse déjà un panorama de tout ce qu’il va falloir ajouter, autrement dit, ré-enregistrer par la suite.
 ProTools, ton meilleur ami
ProTools, ton meilleur ami
- Le
recordeur : intitulé de poste bizarre, qui au final fait du doublage. Bah oui, sur un plateau, parfois on a 3 grues, 2 machines à fumée, 70 personnes et même parfois un réalisateur qui dirige ses acteurs « en live ». Bref, y a du boucan partout et les prises de son directes ne sont pas exploitables. Il faut donc ramener tous les acteurs en studio pour qu’ils doublent leur propre voix. De plus en plus de films font systématiquement appel à ce procédé, le Seigneur des anneaux par exemple. Cela garantit une prise de son hyper-propre. Mais est-ce mieux que le vrai son réel sincère et instantané ? Dans le métier, on va dire qu’il y a 2 écoles…
- Le
bruiteur : véritable OVNI du métier, il vit souvent dans un bordel pas possible, où chaque objet qui traine produit un son bizarre. C’est lui qui va devoir recréer, ou enrichir, les bruitages
réels du tournage. Frottements de vêtements, coups de feu, bruits de pas, porte qui claque, pet de foufoune, chaise qui grince etc… Plus qu’un technicien, le bruiteur est souvent un artiste assez bizarre, capable de recréer la collision d’un train sur une montagne à l’aide de quelques chamallows et d’un berger allemand. Il a pleins de micros bizarres, vit chez sa mère et sait faire pleins de trucs bizarres avec sa bouche. En bref, un métier très difficile et exigeant.
 Des pas sur le gravier? Une biscotte et le tour est joué
Des pas sur le gravier? Une biscotte et le tour est joué
- Le
monteur son ambiance : véritable chasseur de sons, c’est lui qui va, à partir des sons seuls enregistrés au tournage et de sa propre banque qu’il enrichit dès qu’il part en vacances en Alaska, enrichir le montage image en crédibilisant chaque scène. Vent qui souffle, corbeaux lointains, parois d’une caverne ruisselante, rumeur souterraine… Il s’agit d’une partie très créative, où bien souvent les images prennent une autre dimension grâce à l’apport de sons crédibles. Un métier passionnant, qui se fait avec une étroite collaboration du réalisateur et du directeur artistique, tout ceci peut prendre beaucoup de temps, et peut vite grimper jusqu’à une cinquantaine de pistes.
 Un setup classique de montage son
Un setup classique de montage son
- Le
Sound Designer : intitulé assez occulte, dans la mesure où il s’agit souvent d’un monteur son très expérimenté. Egalement présent sur d’autres marchés comme le jeu vidéo, le designer sonore s’occupe généralement de la partir FX sonore, les effets spéciaux quoi… Dans le cas de « Transformateur », il va créer le son des robots, des explosions, des vaisseaux, des cafetières… mais aussi accompagner certains mouvements de caméra par des
SWIIIIiiiiiish ou des
Woooosuushshhsshhhh. Bref, le sound designer, c’est un peu l’homme à tout faire, il recale des machins, crée des trucs, transforme les musiques… Artistique avant tout, mais techniquement très exigeant aussi.
- Le
chef-monteur : il peut très bien être le monteur direct ou le sound designer (ou même tout faire à la fois), c’est lui qui va récupérer les sessions des autres pour tout compiler (en d’autres termes, la fameuse conformation) et en faire la session
maître qui partira au mixage. Il finalise les choses, il fait du tri, il corrige ce qui est jugé foireux, il ajoute ce qui manque, mais également il met tout aux normes : Dolby, 5.1 etc… En bref, il peut engueuler les gens, et faire tout ce qui est techniquement possible pour que le mixage soit le plus confortable possible.
- Le
mixeur : Grand manitou de la post-prod, son travail est capital, dans la mesure où c’est le dernier du processus de production. Généralement, dans son auditorium, tout le monde se pose peinard, boit du café et se repose après tout le bordel des derniers mois. Le monteur son, le réalisateur et le dirlo artistique sont présents, et surveillent de près ce qui doit être fort, moins fort… Mais le mixeur a du pain sur la planche : correction fréquentielle, gestion dynamique, respect des mesures audio, restauration sonore des sources abîmées, bref, il doit beaucoup créer, sans pour autant avoir le dernier mot, qui sera toujours celui du réalisateur. Du mixage dépend l’ambiance sonore entière du film, c’est un métier merveilleux, mais également long et exigeant.

Après tout ça, le film sort en salle, Michel Bon se fait conspuer par la critique et Robert retrouve son doux foyer, bien que sa femme soit partie entre-temps, car elle en a marre qu’il ne soit jamais là et blablabla. Mais ce n’est pas terminé !!!! Il reste le mixage DVD, le mixage Blu-ray, le doublage pour les autres pays, le mixage en vue d’une diffusion TV… Mais ce n’est pas forcément Robert qui va s’y coller, il a fait son taf, il a réuni sa grande armée, et qui sait… aura-t-il sa statuette dorée.
The End.